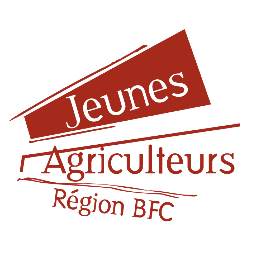Avant 1946, les fermiers et métayers n’avaient presque aucun droit. C’était le propriétaire qui décidait de tout : de l’organisation de l’exploitation, des cultures, et même du destin du fermier. Les contrats étaient souvent verbaux, les prix pas encadrés, et les fermiers vivaient dans une grande insécurité : ils pouvaient être congédiés à tout moment. Il n’était pas rare de devoir changer de ferme chaque année. Après la Seconde Guerre mondiale, une ordonnance du 17 octobre 1945 et une loi d’avril du 13 avril 1946 sont venues compléter le statut du fermage. Cette réforme a limité les prix des baux, garanti des baux de 9 ans renouvelables offrant aux fermiers sécurité et stabilité. L’objectif était clair : protéger les agriculteurs tout en assurant la souveraineté alimentaire de la France.
Le statut du fermage : un régime juridique protecteur
Le statut du fermage est un ensemble de règles qui fixe les droits et devoirs du propriétaire (appelé bailleur) et du locataire agricole (appelé preneur ou fermier). Ce contrat, appelé bail rural ou bail à ferme, permet au propriétaire de confier ses terres ou ses bâtiments à un fermier, en échange d’un loyer appelé fermage.
Le montant du fermage est encadré par un arrêté préfectoral mis à jour chaque année. Aucune majoration n’est en principe possible (sauf investissements particuliers supportés par le bailleur). L’actualisation du loyer est ensuite assurée annuellement au moyen d’un indice national des fermages mis en place en 2010. Ce mécanisme de régulation permet aux exploitants de bénéficier d’un coût de location raisonnable et soumis à de faibles variations. La durée minimale d’un bail rural est de 9 ans, il est renouvelé automatiquement si aucune des deux parties ne s’y oppose. Il existe aussi des baux plus longs, de 18 ou 25 ans, voire pour toute la carrière du fermier. Chaque type de bail a ses propres règles, mais aucun ne peut être rompu avant son terme, même en cas de changement de propriétaire. Le bail rural peut être écrit ou oral. S’il est oral, il est automatiquement considéré comme un bail de 9 ans. Le paiement du fermage sert alors de preuve pour faire valoir les droits du fermier. En principe, le bail rural ne peut pas être transmis à une autre personne. Cependant, une exception existe pour le conjoint, le partenaire de Pacs ou les enfants du fermier.

Le statut du fermage, un outil économique pour l’installation des jeunes
Aujourd’hui, le statut du fermage concerne plus de 80 % de la SAU en France et reste la référence pour la location de terres. Le fermage contribue à éviter la flambée des prix du foncier comme cela peut-être le cas chez nos voisins européens. L’accessibilité des loyers permet notamment à des nouveaux installés d’investir dans leurs outils de production plutôt que d’acheter des terres. Alors que l’agriculture accueille de nouveaux profils, il est essentiel de garantir la pérennité de ce statut en le modernisant, afin qu’il prenne en compte l’évolution des pratiques et les aspirations des agriculteurs. À l’échelle nationale, 63 % des porteurs de projets ne proviennent pas du milieu agricole, et la part des installations hors cadre familial connaît une forte progression.